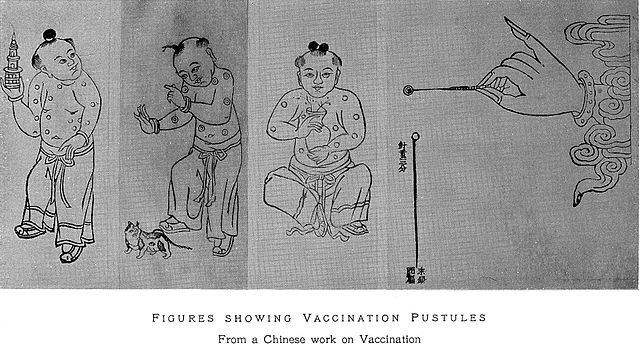Partie 4 « Justice et injustices »
Une erreur dans ce dossier ? Laissez-moi un commentaire argumenté et je modifierai en conséquence.
Un droit de réponse ? Contactez-moi et je le publierai.
Ce dossier est le produit d’un énorme travail d’analyse. Vous pouvez me soutenir en donnant un pourboire, unique ou à chaque publication de contenu, sur la plateforme Tipeee.
Merci aux tipeurices de la première heure, iels sont en bas d’article, merci pour vos commentaires, pour vos partages.
**
Gulbahar Haitiwaji publie, avec Rozenn Morgat, un livre qui fait beaucoup de bruit : « Rescapée du goulag chinois ». Tous les médias en ont parlé. Il semble que nous tenions là un témoignage indiscutable sur la répression et le caractère criminel de l’État chinois, dans le Xinjiang en général, sur les Ouïghours en particulier. Quatrième volet de notre grand dossier. Je vous encourage à lire le premier, le second et le troisième volet avant d’aborder celui-ci.
Les raisons d’un départ…définitif ?
La famille Haïtiwaji n’a pas seulement quitté son pays, la Chine, et sa province, le Xinjiang. Iels ont quitté leur travail, leurs ami.es et le reste de leur famille pour traverser tout le continent eurasiatique et demander refuge à la France. Selon la convention de Genève (1951), un réfugié est « une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou sa résidence habituelle, car elle y a été persécutée ou craint d’y être persécutée du fait de sa race, sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Quels sont les éléments tangibles que relève Mme Haïtiwaji dans son texte pour justifier leur départ au Xinjiang et leur obtention du statut de réfugié en France ?
Ce sont les discriminations au travail qui semblent être la justification principale à leur départ. Mme Haïtiwaji explique qu’iels voyaient leur « perspectives d’avenir se réduire comme peau de chagrin » (p.14), « disparaître » (p.29), que « les salariés Hans ont reçu plus d’argent que les salariés Ouïghours » (p.28), que « tous les salariés Ouïghours ont été délocalisés à la périphérie » (p.29), que « le poste a été dévolu à quelqu’un d’autre » et, « devinez à qui? Un salarié Han ! » (p.29 encore). Ainsi, « Kerim a toujours su qu’il faudrait quitter le Xinjiang » (p.28). Comme dit plus haut, ces éléments entrent toutefois en contradiction avec le fait que « personne » n’aurait pu affirmer « avec conviction » les discriminations subies (p.68). Ce sont donc, tout au plus, des ressentis non objectivés, par exemple, par des statistiques ou des études.
Mme Haïtiwaji dit aussi que ce sont les « différences culturelles » qui « dérangent » et « les épisodes de révoltes passés » qui « inquiètent » ; ce serait « pour cela » qu’iels « ont fui en France en 2006 » (p.23). On ne sait pas si, ici, Gulbahar fait référence aux attaques violentes qui faisaient déjà rage au Xinjiang.

Quoi qu’il en soit, Kerim Haïtiwaji est parti, d’abord au Kazakhstan pour y revenir déçu après un an, puis en Norvège et enfin en France (p.36) où elle dit qu’il avait eu « une opportunité d’emploi » (p.147), ce qui n’est pas cohérent avec le fait qu’il aurait été à la rue à son arrivée (p.37). Leurs filles et lui-même y ont obtenu le statut de réfugié.es.
On voit que les raisons du départ sont loin d’être aussi claires que ce qu’on pourrait penser de prime abord. Voyons maintenant les raisons qui auraient pu inciter la famille à ne pas prendre le départ.
Contrairement à ce qu’elle dit à différentes reprises, Kerim et Gulbahar n’ont pas eu à chercher du travail au Xinjiang puisque « la Compagnie du pétrole locale [leur] a offert des emplois d’ingénieurs dès [leur] sortie de l’université » (p.25). Iels purent s’installer dans un « petit appartement de deux pièces fournis par la Compagnie » (p.26). Étaient-iels mal traité.es dans leur travail ? Difficile à croire sachant que « au fil des années, Kerim et [elle] av[aient] obtenu de meilleurs salaires » (p.29), salaire déjà qualifié de « correct » (p.36) dès le départ. L’année suivante, « à [s]on grand étonnement », « la compagnie [lui] attribua un poste au siège de Karamay » (p.36) et elle « [se] sentai[t] reconnaissante envers elle » (p.36). En fait, elle avait fini par « adorer ce métier » et elle « aimait la compagnie » (p.35). La vie leur « souriait », iels finirent par habiter « un spacieux appartement dans le centre », iels roulaient « dans une belle voiture », leurs filles « poursuivaient des scolarités prometteuses » (le tout p.29).
Dans ces conditions, on comprend qu’il soit difficile d’objectiver les fameuses discriminations subies (notamment celles au travail). On est également loin, très loin, des fameux « joyaux architecturaux » de Kashgar faits de pauvreté et de maisons en terre. Si Gulbahar aussi prend la décision de quitter le Xinjiang en 2006, elle n’a toutefois « pas eu le cœur de démissionner » (p.38) parce que la « Compagnie ne [l]’avait pas blessée » (p.38) et elle demanda un « congé sans solde grâce auquel [elle] conservai[t] [s]a place d’ingénieur-cadre dans l’entreprise » (p.38).
Tous ces éléments en tête, à quels critères exacts de la définition de la convention de Genève la situation des Haïtiwaji correspond-elle pour justifier l’obtention du statut de réfugié.e ? Pour ma part, je reste perplexe. Sans compter que le statut de réfugié.e est aussi accordé pour protéger cellui qui en jouit d’un retour forcé dans son pays qui le mettrait en danger. Or, lorsqu’il lui a été demandé de retourner au Xinjiang pour régler des problèmes administratifs, « Gulbahar ne s’est pas méfiée, pas assez » (p.16). Et, effectivement, on se demande pourquoi et comment il est possible de retourner volontairement dans un pays qu’elle a quitté pour y avoir été persécutée.
Sauf si, en fait, elle n’y était pas persécutée.
Sauf si, en fait, c’était loin d’être la première fois qu’elle y retournait depuis son départ en 2006.
Ainsi, elle explique qu’à l’été 2009 elle était « rentrée seule à Altay » (Xinjiang) parce que son mari, à cause du statut de réfugié, n’avait pu les accompagner (p.41). Mais ça n’est pas cohérent non plus avec le fait qu’elle dise (p.42) que toute la famille est retournée au Xinjiang en 2012, soit trois ans plus tard, pour « rendre visite à [leurs] familles et amis ». Une exception ? Pas du tout. Elle précise « comme chaque année » (p.42). Donc, chaque année, la famille Haïtiwaji retourne au Xinjiang, sans apparemment craindre d’y subir quoi que ce soit et ce en dépit du statut de réfugié de Kerim et des filles. Et c’est à ces occasions que Kerim servait d’informateur auprès des autorités. « Mentez, il en restera toujours quelque chose ».
L’ambiguïté des relations entre Mme Haïtiwaji et les autorités chinoises culmine après son procès et sa sortie du camp de rééducation. En résidence surveillée, elle dit le 15 mars 2019 découvrir « avec un goût particulier la douce sensation d’habiter un endroit qui [lui] appartient » (p.208) et ce en dépit de la présence de onze policièr.es. Avec elleux, l’atmosphère a été « sincèrement joyeuse » (p.208). Du reste, quand sa mère lui rendait visite au camp de Baijiantan, elle « riait avec les policiers » et Gulbahar ne l’explique qu’en considérant que ces derniers faisaient preuve d’une gentillesse « sournoise » qui « tombait comme un voile sur ses yeux » (p.219). Est-ce vraiment cohérent avec l’idée qu’on se fait de la souffrance d’une population génocidée ? Lorsque sa mère la rencontre dans la résidence, elle trouve sa fille « pas trop amochée et même en forme » (p.219).
Alors qu’elle a pu louer son propre appartement, Gulbahar reçoit en août une terrible nouvelle : sa mère a fait un AVC et se trouve entre la vie et la mort (p.223). Israyil, le policier chargé de sa surveillance, lui autorise de la retrouver. Enfin, pas seulement. Il « assurerait [s]es déplacements [lui] évitant les longueurs insupportables des contrôles de police » (p.224). En fait, « sa bonté » à l’égard de Gulbahar avait « fini de [l’]étonner » et « la frontière qui séparait [leurs] deux mondes s’affaissaient » (p.226). Elle était devenue pour lui « un individu que l’on surveille mais aussi sur qui l’on veille » parce que « dans l’esprit des policiers, il n’existe qu’un pas entre ces deux termes » (p.227). Il s’empressera également de rencontrer la direction de l’hôpital « pour s’assurer [que la mère de Gulbahar] soit prise en charge par les meilleurs médecins » (p.227). Dans les yeux « inquiets » du policier, Gulbahar « ne voyait plus que de la gentillesse » (p.227).
Justice illégale ?
Une part importante de l’argumentaire de Gulbahar Haïtiwaji repose sur le caractère illégal et liberticide de sa (ses) détention(s) (dès la p.13). Comment se sont déroulées les étapes de son arrestation, de son emprisonnement et de sa libération ? À quel point les procédures décrites diffèrent-elles de ce qui est attendu dans une démocratie ? Je fais ici un travail de synthèse et de clarification des éléments compris dans le livre, sachant que celui-ci n’est pas toujours écrit de façon chronologique et qu’il nous faut croire Mme Haïtiwaji sur parole, en dépit des très nombreuses incohérences relevées plus tôt. J’invite les lecteurices à vérifier l’exactitude du déroulé ci-dessous et à compléter ou corriger ce qui devrait l’être si je devais avoir fait des erreurs.
Dans les locaux de la Compagnie où elle est venue signer ses papiers (autour du 25 novembre 2016), elle dit avoir été arrêtée puis interrogée (p.47). On lui montre la photo de sa fille participant à une manifestation de l’Association des Ouïghours de France, avec à la main le drapeau du Turkestan oriental (voir supra). Elle est libérée (p.49) mais la police garde son passeport ; elle reste donc à la disposition de la police.
Un mois plus tard (autour du 1er janvier 2017), elle sera mise en garde à vue (p.46). Alors qu’elle « sillonne » le Xinjiang, elle reçoit un appel lui demandant de rentrer à Karamay (p.51). Elle passera un premier séjour dans la cellule de la Maison d’arrêt de Karamay (p.46) après qu’elle eut reconnu avoir participé à des « troubles en réunion » (p.45) – des aveux dont elle dit qu’on les lui a extorqués. Pendant cette période, elle est interrogée plusieurs fois et ment régulièrement, notamment sur les personnes qu’elle connaît ou pas (p.65). Jusqu’ici, Gulbahar Haïtiwaji n’évoque pas la possibilité d’être défendue par un.e avocat.e, ce qui est contraire, par exemple, au droit belge. Si l’on devait comparer ce que vit alors Mme Haïtiwaji avec ce qu’on connaît ici, on appellerait « détention préventive » son enfermement dans la maison d’arrêt de Karamay. Notons qu’en Belgique aussi il est fréquent de rester en prison plusieurs mois avant même d’être jugé, mais en étant défendu par un avocat et en ayant accès à son dossier, ce qui semble ne pas être le cas ici.
Début juin 2017 (p.73), elle apprend qu’elle quitte la prison pour rejoindre un centre de rééducation, une « école ». Elle va ensuite passer plusieurs mois dans des camps de rééducation (jusque p.179), l’essentiel à Baijiantan. Durant l’hiver 2017, elle dit que son dossier arrive sur le bureau du Quai d’Orsay en France (p.132). Au printemps 2018, elle dit être retenue depuis bientôt deux ans au Xinjiang (p.132, p.134), ce qui est factuellement exagéré – il s’agit d’un an et trois mois (elle entre en garde à vue en janvier 2017). Début octobre 2018, ses codétenues et elles sont transférées dans un camp plus grand, à quinze minutes en camion de Baijiantan (p.139-140).
Un peu plus de deux mois plus tard (23 novembre 2018), elle assiste à ce qui semble être son premier procès, accompagnée de sa tutrice (p.143) que l’on pourrait lointainement assimiler à une avocate (lointainement car, si l’on en croit les descriptions de Mme Haïtiwaji, sa tutrice « n’a pas dit un mot pendant les neuf minutes qu’a duré mon procès » (p.146)). Elles sont plusieurs à être jugées ce jour-là, « les deux premières ont été innocentées » et « la troisième a pris trois ans de rééducation » (p.144). Elle est à nouveau interrogée sur différents éléments politiques (concernant les activités de sa fille et de son mari) et sur des éléments administratifs. Gulbahar finit par une déclaration « qui […] ne manquait pas d’hypocrisie », dans la mesure où « simuler la repentance était vital » (p.148). Elle est alors condamnée à retourner dans un centre de formation, une école, pour sept années, sachant que sa peine « ne courrait peut-être pas jusqu’à son terme » (p.149). Gulbahar se retrouve alors dans « le bâtiment de celles qui ont été jugées » (p.150).
En revanche, il semble ici que Gulbahar se méprenne sur le rôle d’un procès. Elle dit (p.146) : « […] Dans un vrai procès il y a une accusée qui est une accusée, c’est-à-dire une personne qui a commis des actes et qui est susceptible d’être condamnée. Moi je suis innocente. » Or, le principe d’un procès est précisément d’établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.e. Il arrive donc que des innocent.es soient accusé.es, eussent-iels passés injustement plusieurs mois en détention préventive. Que l’on soit en Belgique ou en Chine.
Fin décembre 2018, elle dit être emmenée dans une nouvelle maison d’arrêt, qui ressemble, en plus grand, à la première qu’elle avait fréquentée à Karamay. Les interrogatoires sont nombreux, le policier qui s’occupe d’elle veut « clore ce dossier » (p.170). On lui demande des précisions sur les éléments les plus politiques (l’Association des Ouïghours de France, le séparatisme, Rebiya Kadeer, etc.) jusqu’à la considérer comme « prête » pour des aveux filmés. En février 2019, Gulhumar Haïtiwaji plaide la cause de sa mère sur un plateau de France 24. Le 12 mars 2019, on lui annonce qu’elle est « libre » (p.178).
C’est en fait un chemin « progressif » vers la liberté qui l’attend. Elle passera d’abord du temps dans une chambre du bâtiment attenant à la maison d’arrêt où elle avait été détenue au départ (p.181), mais avec « pain chaud », « matelas moelleux » et « écran plat ». Un mois plus tard, elle peut sortir accompagnée dans les rues de Karamay (p.198). En juin 2019, elle est transférée dans un appartement du centre de Karamay où elle vit encore avec les policiers. Durant cette liberté conditionnelle, on lui « donne de l’argent » (p.212). C’est dans cet appartement qu’elle reçoit la visite de sa mère et de sa fille plusieurs jours. Durant cette visite, les policiers les laissent seules. Début juillet 2019, elle est autorisée à louer son propre appartement mais sa mère tombe malade. Comme vu plus haut, le policier le plus proche de son dossier l’aide alors à la retrouver au plus vite et veille sur elle. Le 21 août 2019, elle retourne enfin en France.
Qu’en penser ?
D’abord qu’il est difficile de considérer la situation de Mme Haïtiwaji comme généralisable à l’ensemble des détenu.es ouïghour.es. En effet, comme elle le précise elle-même (p.132), « [son] dossier fait partie de ces cas sensibles que les autorités dissimulent », essentiellement pour ses liens avec l’étranger. Cela n’est pas très étonnant si l’on considère les éléments vus supra et la possibilité d’une affaire d’espionnage ou de contre-espionnage. Le contexte géopolitique et la guerre froide sino-américaine ne peuvent être occultés.
On note ensuite que les camps eux-mêmes ne sont pas, comme le dit Gulbahar page 135, des dispositifs extra-légaux : la Chine a « mis au point un système légal permettant de justifier l’existence de ces camps ». Bien entendu, le contenu de la loi peut lui-même être illégitime ou immoral à nos yeux – c’est là une question de point de vue.
Sur le plan légal, l’absence d’une défense et d’un accès au dossier pour justifier la détention préventive sont des différences majeures avec ce qui prévaut, par exemple, en Belgique. Le temps passé en détention préventive avant le procès n’est en revanche pas surprenant, sachant qu’en Belgique il n’existe « aucune limite temporelle quant à la durée de la détention préventive ». Par ailleurs les conditions matérielles de la détention en camp de rééducation, sur base des informations données par Mme Haïtiwaji, ne semblent pas comparables à l’état de la plupart de nos prisons. On lit par exemple sur le site de l’Observatoire International des Prisons que, « de manière générale, les conditions de salubrité et d’hygiène, ne se sont pas du tout améliorées ces dernières années et la majorité des lieux de détention belges ne sont toujours pas conformes aux règles d’hygiène et de sécurité les plus élémentaires. »
Le système judiciaire présente des différences incontestables avec les systèmes belge ou français. L’absence de séparation des pouvoirs, telle que nous l’envisageons, semble laisser le champ libre à une grand part d’arbitraire mais elle est en revanche cohérente avec un héritage mêlant communisme et confucianisme.
Il appartiendra évidemment aux lecteurices, sur base seulement des éléments tangibles et non-contradictoires évoqués par Mme Haïtiwaji, de porter un jugement moral quant à la sévérité de la peine qu’elle a subie, eu égard aux enjeux géopolitiques majeurs dont il est question et sur lesquels il nous faut encore revenir. C’est ce travail de recontextualisation que nous ferons dans le cinquième volet de notre grand dossier.
Merci à mes tipeurices : smart684, Rosie-6, gendre-daniel, g106973983737661016119, wen-3, fillon, eva-17, jean-do-5b8e, marsxyz, f-ines-5a3f79.
Pour me soutenir avec un pourboire, suivez ce lien.